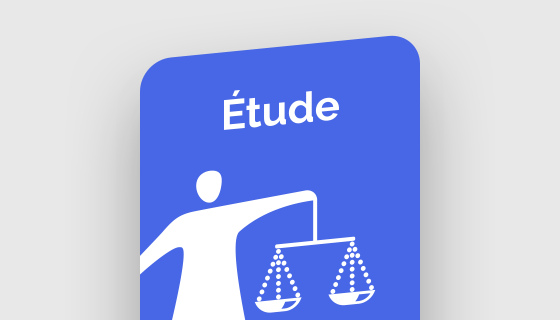Mardi 12 avril, un homme entre dans une rame du métro de New York, il déclenche deux bombonnes de fumée et tire au hasard. Le bilan est lourd, mais le pire aurait été évité avec 23 blessés mais dont aucun ne serait en danger de mort. En attendant que la police éclaircisse les tenants et les aboutissants de ce fait divers, il met en lumière un phénomène préoccupant dans la ville la plus peuplée des États-Unis. En effet, depuis plusieurs décennies, New York est le véritable laboratoire des politiques publiques quant à la criminalité.
Dans les années 1990, la ville de New York était proprement Gotham City et avait une très mauvaise réputation.
Le nombre de crimes violents avait connu une hausse sans précédent: +300% de crimes
violents entre 1960 et 1990. Le nombre d’homicides atteignait des sommets: 2245 homicides en 1990. Pour comparaison, il y a en France un peu moins de 1000 homicides par an, quand nos voisins
italiens font encore mieux avec 245 homicides pour l’année 2020.
Bref, la ville de New York dans son entièreté était devenue extrêmement dangereuse.
Cette situation avait poussé les New-Yorkais à quitter la ville pour s’installer dans les banlieues et à notoirement éviter le métro, entièrement recouvert de graffitis tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des rames. À l’époque, le fatalisme régnait. Le FBI, par exemple, dans son rapport annuel national sur la criminalité prévenait: «l’homicide criminel est en grande partie un problème de société qui échappe à l’action de la police».
Mais, en 1994, a débuté à New York un des phénomènes criminologiques les plus spectaculaires de l’Histoire moderne.
Cette année-là, est arrivé à New York un homme du nom de William Bratton. Bratton avait été nommé chef de la police de New York par le maire républicain Rudy Giuliani et il ne croyait au fatalisme sur la criminalité. William Bratton adhérait plutôt à plusieurs théories sociologiques et criminologique: d’abord la théorie de la vitre brisée, celle selon laquelle une vitre brisée dans un quartier produit un effet négatif décuplé en envoyant le message aux citoyens que ce quartier est abandonné. Bratton croyait en la tolérance zéro et il croyait en la rationalisation du crime.
“Si tous les petits délinquants ne sont pas des criminels, tous les criminels commettent de petits délits. ”Pierre-Marie Sève
Tout a commencé dans le métro new-yorkais. Bratton y avait été chef de la police des transports et avait commencé à expérimenter ses théories. La première stratégie mise en place concernait les fraudeurs à l’entrée du métro. En application de la tolérance zéro, la police des transports avait décidé de systématiser les contrôles de billets. Bien sûr, de nombreux New-Yorkais ayant pris l’habitude de frauder mais honnêtes par ailleurs, ont grincé des dents. Mais une minorité importante des personnes arrêtées aux portiques, s’avéraient être des gros bonnets, des criminels en puissance. En effet, si tous les petits délinquants ne sont pas des criminels, tous les criminels commettent de petits délits.
Additionnellement, cette tolérance zéro était vue comme un impératif moral pour la police de New York car ce sont les habitants des zones les plus défavorisées qui sont les premières victimes de l’insécurité.
Parallèlement, fidèle à la théorie de la vitre brisée, Bratton a posé une interdiction aux rames pleines de graffitis de circuler. Le nombre de trains a drastiquement diminué au début, mais petit à petit, le message est passé aux auteurs de graffitis : « votre graffiti sera nettoyé dans la journée où vous l’aurez faite et il ne sert à rien de perdre des heures. » Les auteurs de graffitis, eux, étaient systématiquement poursuivis, ce qui était une petite révolution pour la régie des transports New-Yorkais. Soudainement, le nombre de crimes violents diminua drastiquement et le nombre d’usagers du métro grimpa en flèche.
…